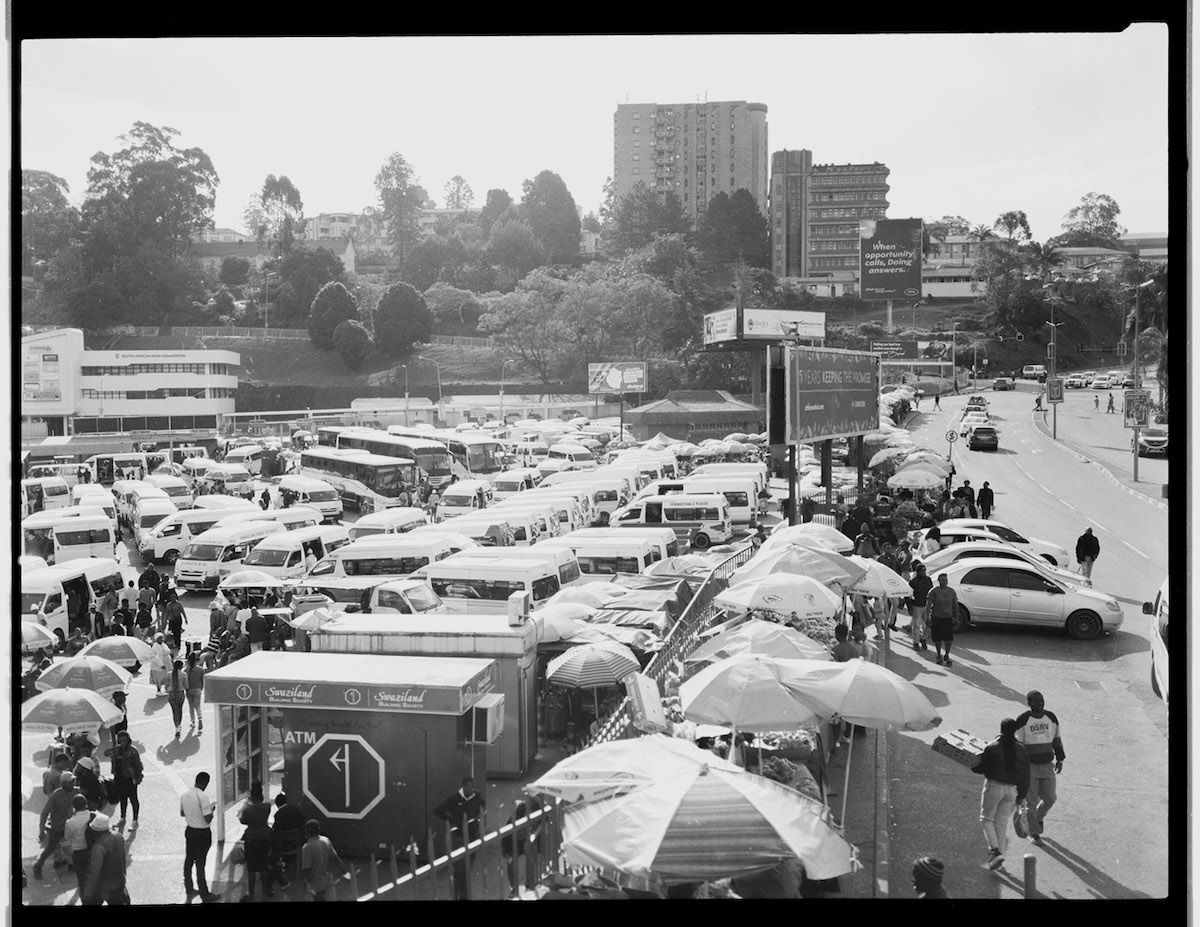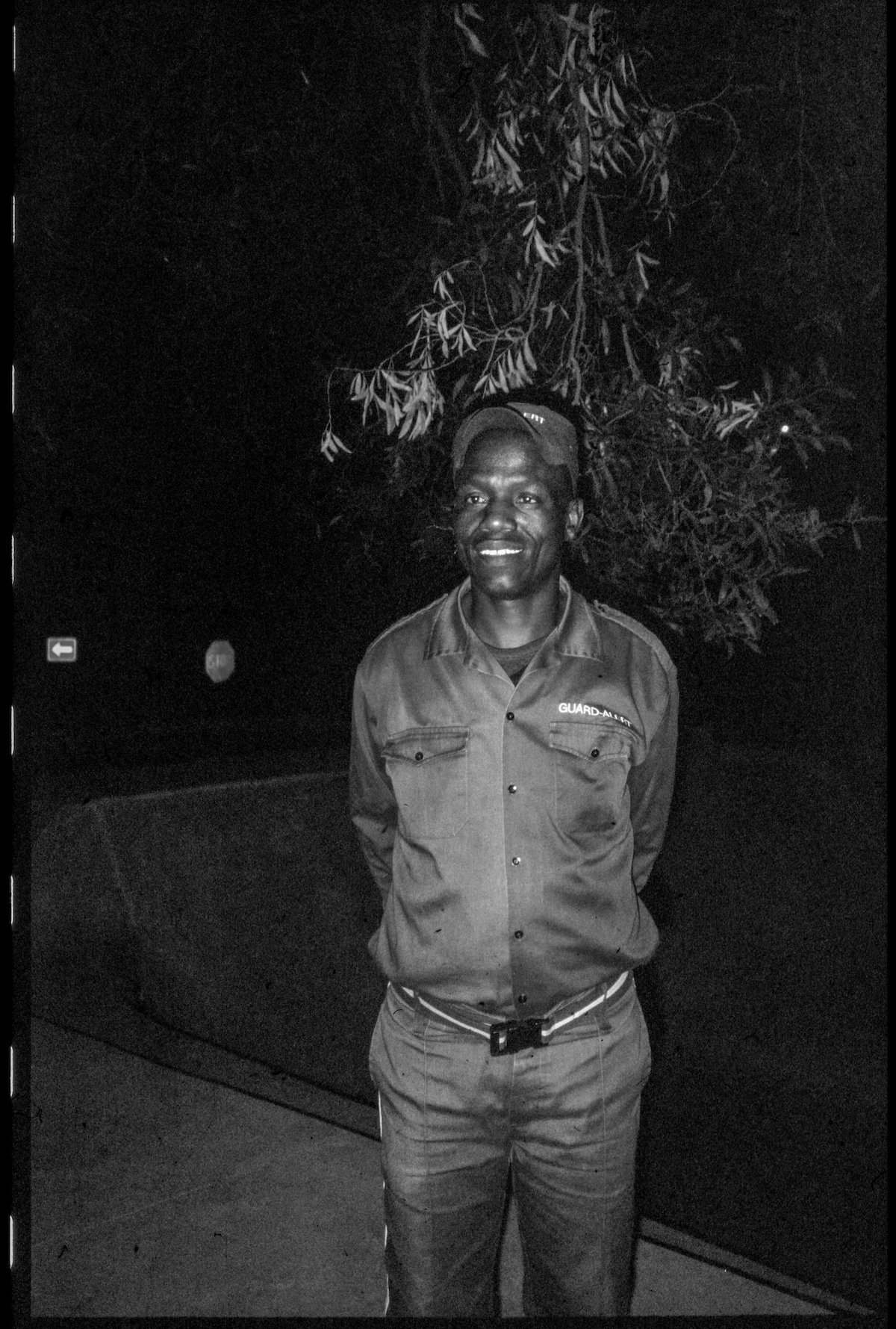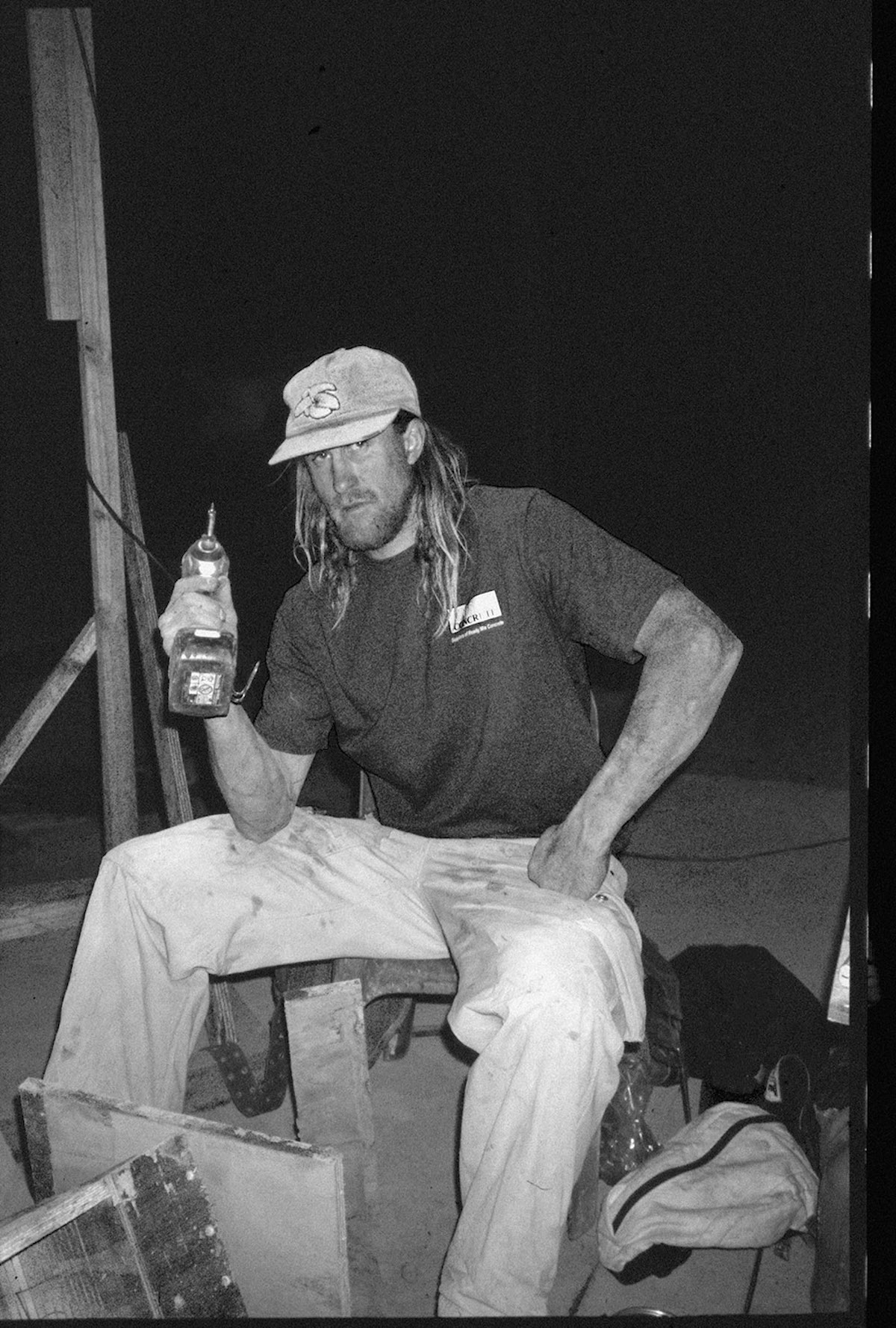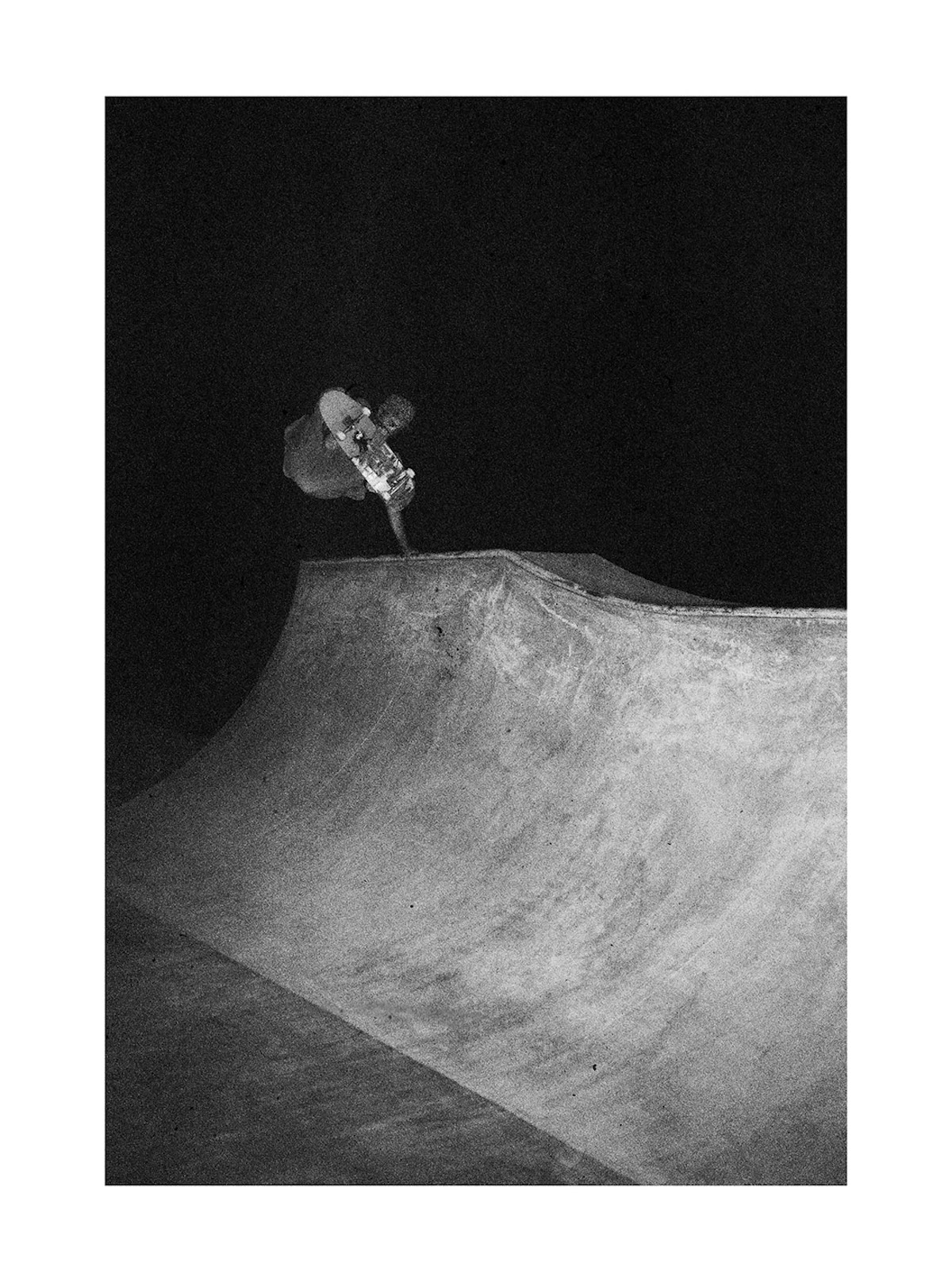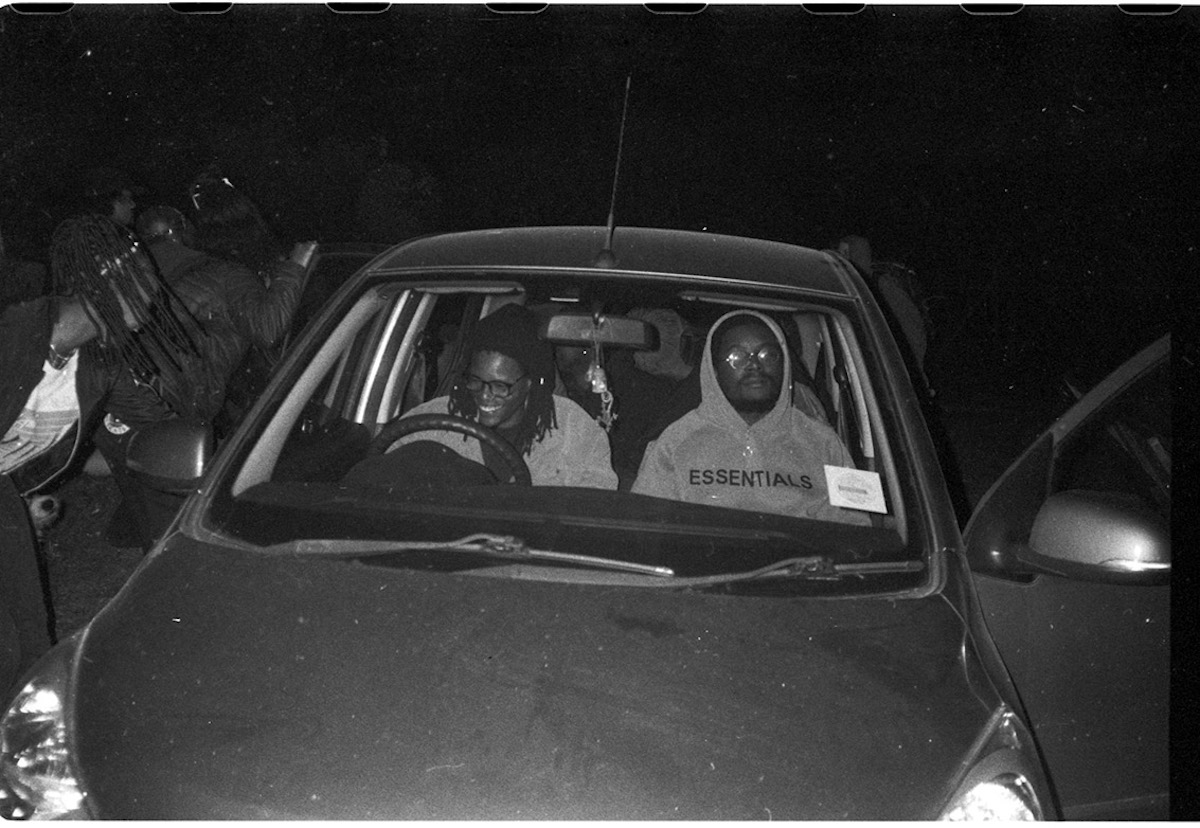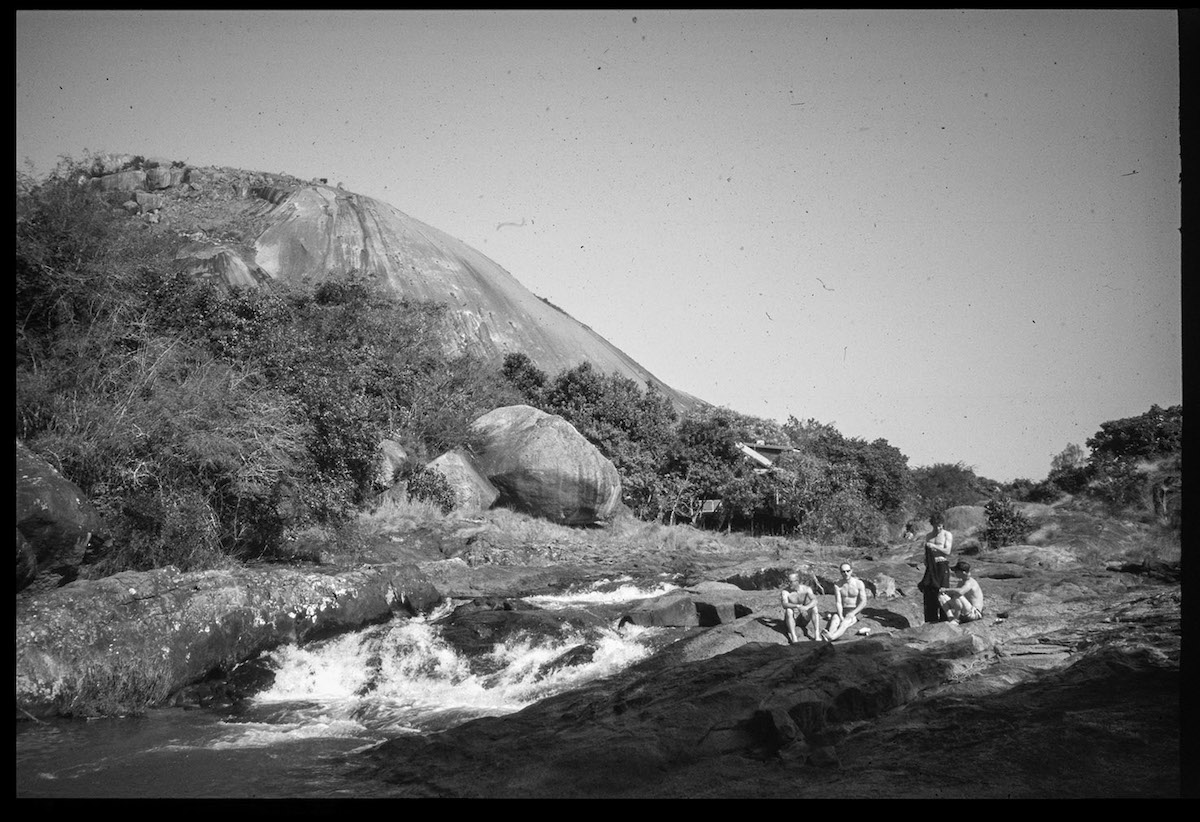Quand les startups « anti-gaspi » mangent à la place des plus précaires
Je dois avouer que je dédie le peu de compassion et d’empathie que j’ai aux animaux. La seule association pour laquelle j’ai donné de mon temps et un peu de mon argent est la SPA. Mais quand j'ai reçu un mail de l’asbl L’Ilot m’informant d’une nouvelle crise dans le secteur du sans-abrisme et de l’aide alimentaire, ça m’a fait tiquer. Dans ce nouveau combat, il est question de startups lucratives – comme Happy Hours Market ou Too Good to Go – qui depuis quelque temps mangent littéralement les vivres dont pourraient bénéficier les associations.
En gros, l’activité de ces startups couplée à la franchisation croissante des grandes surfaces – lesquelles vont préférer passer un deal avec ces nouvelles applications – plonge les associations dans une situation de concurrence dont elles vont d’office sortir perdantes.
Pour ce nouveau combat, L’Ilot s’est allié à LOCO, un réseau d’organisations qui collecte et redistribue les invendus alimentaires aux personnes dans le besoin. J’ai échangé à propos de tout ça avec Benjamin Peltier, chargé de plaidoyer, dans leurs locaux à Bruxelles. Après une petite heure de papote, on a conclu en disant que, pour le moment, le secteur de l’aide alimentaire c’était le far west. « Sans cadre légal, c'est le plus fort qui impose sa loi : dans notre secteur, les plus petits se font écraser et doivent se plier aux règles qu’ils subissent », résume Benjamin.
VICE : Comment ça se passe pour le moment ici ?
Benjamin Peltier : Dans ce secteur, y’a des assos avec une grande diversité. La majorité s'occupe des colis d'aide alimentaire pour des personnes précaires – le grand acteur historique de ce secteur, c'est la Croix-Rouge. Y’a aussi beaucoup de micro-acteurs, à l'échelle d'un quartier, d'une rue, avec un peu de solidarité qui s'organise. Ça peut être à l’initiative d'une paroisse, d'un frigo solidaire… Une bonne partie des assos qui font de la distribution alimentaire sont 100% bénévoles. Donc c'est un secteur peu professionnalisé et qui a du mal à se fédérer pour se défendre face à ce qu'il se passe. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme LOCO avec d'autres acteurs qui, non seulement font de la récolte d'invendus pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres assos plus petites qui n'ont pas les moyens de récolter… Tout cet écosystème est tablé sur les invendus de grandes surfaces mais aussi des marchés hebdomadaires ou des centres de distribution. Y’a des accords qui ont été faits, notamment avec les chaînes de supermarchés pour nous permettre de récolter de l’alimentaire.
Et ces accords n’ont pas suivi ?
Quand les acteurs privés sont arrivés – To Good To Go l'un des premiers –, ils se sont positionnés comme acteurs complémentaires à nous. Ils étaient plutôt sur les commerces de quartier qui avaient des invendus : la petite épicerie, la boulangerie, etc. À ce moment-là, leur politique de non-gaspillage était respectée. Nous, on n’était pas sur ce créneau donc on se marchait pas trop dessus. Maintenant, To Good To Go, tout comme Happy Hours Market, s’est aussi lancé sur les invendus de grandes surfaces. Les deux explosent, aussi en termes d'outils, de camions, de points de distribution. Et ils visent vraiment les grandes surfaces sur lesquelles on était.
Dans un premier temps, L'Ilot a pu être protégé par des accords qu'on avait avec les magasins et, vaille que vaille, ça tenait. Delhaize, par exemple, avait un programme zero waste où ils avaient passé un accord avec toutes sortes d'assos pour la récupération d'invendus alimentaires, donc notre secteur pouvait toujours bénéficier de denrées [malgré la nouvelle concurrence]. Mais ces derniers mois, y’a eu un coup d'accélérateur dans la franchisation des magasins Delhaize – en plus de celles des magasins Carrefour et Intermarché qui avaient précédé. À partir de là, chaque gestionnaire peut commencer à négocier ses trucs et l'offre que propose Happy Hours Market est forcément plus intéressante pour les magasins parce que ça valorise financièrement leurs invendus alimentaires. Face à ces gérant·es de franchises qui sont soumis·es à des contraintes financières extrêmement difficiles, on ne trouve plus notre place et c'est logique de les voir aller vers ce type d'acteurs.
Vous avez perdu beaucoup d'accords ?
Nous on dépend surtout de trois grandes surfaces Colruyt et, pour le moment, ces accords tiennent. Mais au sein de LOCO, pour certains acteurs c'est la catastrophe. Par exemple, le Centre de Distribution Alimentaire Gratuite (CDAG) qui est financé par le CPAS d’Uccle avait des accords avec neuf magasins Delhaize, et ils en ont déjà perdu six – les trois derniers risquent de tomber d'un jour à l'autre. En plus, le CDAG c'est un gros acteur ; pour les plus petits c'est encore plus un problème. Dans tous les cas, le nombre de personnes précarisées qui viennent chercher nos colis alimentaires est toujours aussi important, voire de plus en plus important, mais on n’a plus autant à leur donner.
Ça peut tomber d’un jour à l’autre pour vous aussi ?
Les trois magasins Colruyt dont dépendent L’Ilot ne sont pas encore entrés dans la logique Happy Hours Market. On est pour le moment protégé. Mais en Flandre, la chaîne Colruyt commence déjà à passer des accords donc ça nous pend au nez… Et quand on sait que 90 000 personnes à Bruxelles vivent de l'aide alimentaire [selon la Fédération des services sociaux, NDLR], ça nous fait peur.
Quel son de cloche du côté des startups ? Certaines ont dit avoir mis en place un système de dons pour vous soutenir ou encourager les magasins à poursuivre des démarches d’aides aux assos.
L'un des premiers contacts qu'on a eu avec To Good To Go c'était en 2018 et, au début, on n’était pas du tout dans l'opposition. On a essayé de mettre des balises communes, comme pour dire qu’il y avait de la place pour tout le monde [des accords à l'amiable, sans trace écrite, NDLR]. Le fait de ne pas venir démarcher des supermarchés avec qui on a déjà des accords est un exemple. L'un des arguments de Happy Hours Market c'est de dire qu'il y a du gaspillage alimentaire malgré notre action, donc pour eux on n’est pas concurrents. Mais en réalité, ils sont rapidement devenus des vrais prédateurs sur les mêmes biens que nous – des denrées dont on peut bénéficier, loin de la date de péremption. Maintenant, Happy Hours Market n'est plus dans le projet d'éviter du gaspillage mais dans celui de trouver les biens les plus exploitables et rentables.
Ils communiquent aussi l’argument de la redistribution aux assos, le fait qu’ils jouent un rôle de plateforme logistique. Ils disent aller chercher dans les magasins, revendre une partie et redistribuer le reste aux assos qui n'ont pas les moyens de faire cette collecte. Mais dans les faits, plusieurs organisations au sein de LOCO ont été partenaires avec Happy Hours Market et bénéficiaires des dons mais se sont ensuite retirées de ce partenariat parce que ce qu'elles recevaient était de trop mauvaise qualité. Y’a pas de réelle volonté d'aider les assos, c'est juste une manière de se décharger des déchets. La gestion des poubelles dans le secteur est extrêmement coûteuse. À cause de ça, le coût de déchets avait doublé dans certaines assos, presque triplé, alors que leur volume de colis distribués avait à peine augmenté – vu qu'elles recevaient des produits périmés.
Est-ce que le succès de ces startups – potentiellement auprès de personnes précaires – permettent d’amortir la demande chez vous sur le long terme ?
En théorie, on pourrait se dire ça. Mais y’a quelques éléments qui laissent penser que leur public n'est pas un public précaire spécifiquement. Quand on regarde la localisation des boutiques Happy Hours Market, elles sont principalement situées dans les communes plus riches : Etterbeek ou Ixelles, notamment. C'est pas Molenbeek et Saint-Josse qui captent leurs boutiques. On voit que ça correspond à une catégorie sociale qui n’est pas précaire. Et puis, y’a l'élément de la fracture numérique : les plus pauvres ont un moins bon accès à la compréhension du numérique. Or, leur modèle repose exclusivement sur des achats via une application web. Et ils communiquent principalement sur le côté écologique de leur activité. À partir de là, on sait exactement quel public ils visent : plutôt des classes moyennes sensibilisées aux enjeux environnementaux. Le seul public qui peut être dans des difficultés d'accès à de la nourriture tout en ayant l'éducation numérique, c'est les étudiant·es. Effectivement, certain·es sont dans la dèche.
Face à une précarité qui a beaucoup augmenté à Bruxelles, comment on gère le contact avec les gens ?
La difficulté des associations qui font de la distribution dans ce contexte c'est de répondre à une demande qui vient avec beaucoup de frustrations, de colère et de violence parfois. La majorité des bénévoles sont des personnes plus âgées qui sont confrontées à des gens qui deviennent parfois agressifs. Y’a des burn-out dus à ces tensions. Les impacts en cascade sur le terrain se voient aussi.
Tu parles d’une violence qui répond directement aux violences – ou à la non-action – institutionnelles ?
Totalement, et ça touche plein de secteurs différents. Le chômage, par exemple : c'est tellement difficile de l'avoir, avoir juste un contact téléphonique ou quelqu'un en face de soi à un guichet pour répondre à son dossier que les gens deviennent fous. Ils n'ont pas les moyens de vivre sur leurs réserves, parce qu'ils n’en ont pas. Les employé·es de la CSC des guichets chômage disaient qu'ils ferment parfois parce qu'ils savent plus capter toute la violence des gens qui font la file et pètent des câbles. Ce sont ces gens qui font la file pour avoir des colis alimentaires mais qui repartent les mains vides. Le sentiment des travailleur·ses sociaux c’est qu’il y a une réelle violence institutionnelle à l'égard des personnes précaires depuis quelques années.
En dehors de nos frontières, vous savez comment ça se passe ?
La France est une des pionnières en Europe de l'encadrement légal dans ce secteur. Elle a un cadre légal qui oblige les magasins avec une surface de 400 m2 à donner leurs invendus aux assos [conformément à la Loi Garot, adoptée en 2016, NDLR]. Et grâce à cette loi, les acteurs s'organisent pour respecter ce cadre légal. Toujours en France, y’a Phenix qui, en théorie, ressemble à Happy Hours Market mais en pratique ils s'associent vraiment avec des initiatives et partagent leurs récoltes en amont de leurs ventes.
Et de notre côté, imposer un cadre légal serait illusoire ?
On a déjà amorcé des conversations avec le monde politique pour leur expliquer ce problème de concurrence. Y'aura-t-il moyen de sanctuariser quelque part les invendus alimentaires pour dire que les personnes qui les donnent aux plus nécessiteux·ses sont prioritaires ? Le cabinet Maron, pour la Région bruxelloise, vient de faire passer une législation pour obliger les grandes surfaces de plus de 1 000 m2 à donner leurs invendus à une initiative. C'est bien que ça avance, mais on dédie quand même de plus en plus d'argent à construire une alternative politique par nous-mêmes, faire passer des messages dans les médias, à pousser pour un changement de société plus global. La situation sociale à Bruxelles ne fait que s'aggraver.
VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.